Retraite en France
En France, le système de retraites est basé pour la majeure partie sur le principe de la répartition, les cotisations des actifs permettant de payer les pensions versées aux retraités.
Recherche sur Google Images :
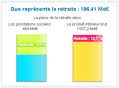
Source image : premalliance.com Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- ... Forums France. Societe : Comment voyez-vous votre retraite ? : La réforme du dispositif de retraites est désormais définitivement adoptée par... (source : france-info)
- ... La réforme des retraites en France qui va reporter l'âge légal de la retraite, aujourd'hui à 60 ans, ne concernera pas les salariés des ... (source : lemonde)
- Six principes pour réformer les retraites en France - Jacques Bichot... Fusionner l'ensemble des régimes de retraites par répartition au sein d'un régime unique... (source : institutmontaigne)
| Économie de la France | ||
|
|
||
| v. / m. |
En France, le système de retraites est basé pour la majeure partie sur le principe de la répartition, les cotisations des actifs permettant de payer les pensions versées aux retraités. Ce dispositif comporte de nombreux régimes spéciaux. Il fait l'objet depuis les années 1990 de réformes successives vivement contestées. Il est envisageable de distinguer trois courants : ceux qui veulent conserver le dispositif tel qu'il existe, ceux qui veulent le réformer partiellement et ceux qui veulent une remise à plat du dispositif avec l'instauration d'un régime par points[1], [2].
Présentation
La totalité est particulièrement fragmenté puisqu'«il existe en France plus de 600 régimes de retraite de base, [et] plus de 6 000 régimes de retraites complémentaires»[3]. On peut distinguer quatre grands pôles[3] :
- le secteur privé ajoute à la retraite de base des retraites complémentaires, versées par des organismes relevant de l'Agirc et de l'Arrco, et des Retraite-chapeau, prévues par le code général des impôts. [4][5][6].
- Les régimes autonomes des artisans, commerçants, professions libérales, mais aussi la mutualité sociale agricole
- Le secteur public compte trois dispositifs, selon trois grands groupes d'employeurs :
- les fonctions publiques territoriale et hospitalière, dispose d'une caisse commune pour le régime de base : la CNRACL.
- Les fonctionnaires d'État (et des organismes qui dépendent de l'État) n'ont pas de caisse indépendante, c'est leur employeur qui paye directement les pensions de base.
- ces trois fonctions publiques partagent en outre des régimes complémentaires. Comme la retraite des fonctionnaires (territoriaux, hospitaliers et d'État) ne tient pas compte des primes, des régimes facultatifs par capitalisation ont été créés dès 1967 (PREFON par exemple) [7]. Pour les non-titulaires, il existe un régime complémentaire obligatoire, l'IRCANTEC. Enfin la réforme de 2003 (voir infra) a créé un régime obligatoire par capitalisation et par points, la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) [8].
- Les régimes spéciaux de retraite surtout à la SNCF, à la RATP ainsi qu'à l'EDF-GDF[9], réformés en 2007.
Ces différentes composantes n'ont que peu de points communs, fixés par une loi, et qui d'autre part supportent quantités de dérogations :
- l'âge légal d'ouverture des droits est fixé à 60 ans
- l'âge d'annulation de la décote de 65 ans, qui sert à prendre sa retraite en ayant droit à une pension à taux plein même en cas de carrière partielle (cet âge légal sera pro|gressivement repoussé à 67 ans, à raison de 4 mois de plus par an à partir de 2011)
- une durée de cotisation de référence, croissante progressivement (162 trimestres en 2010 et 1 trimestre de plus par an jusqu'à un niveau aujourd'hui prévu de 164) [10], base pour des calculs de décotes en cas de départ avant l'âge légal et avant d'avoir cotisé suffisamment, ou de surcote en cas de cotisation plus longue (voir infra). Le projet de Loi de réforme de la retraite de 2010 prévoit de définir la durée de cotisation indispensable à l'obtention du taux plein par décret. Un premier décret à paraitre avant le 31 décembre 2010 fixera la durée de cotisation des générations 1953 et 1954 puis un décret paraitra chaque année pour fixer les durées de cotisation des générations suivantes[11]. L'augmentation envisagée en 2010 portera la durée de cotisation à 165 trimestres pour les générations 1953 et 1954 puis marquera un palier avant d'atteindre 166 trimestres pour les génération 1960 et suivantes[12].
A côté de ces organismes, il existe des systèmes de retraite par capitalisation. Certains peuvent être souscrits de façon individuelle, dans le cadre des plans d'épargne retraite populaire (PERP) pour les salariés du régime général et de nombreux autres cadres (PREFON, COREM, CRH, FONPEL, CAREL) pour les fonctionnaires et les élus locaux. D'autres sont souscrits dans un cadre professionnel : PERCO et Plan d'épargne retraite entreprise pour les salariés du privé, régimes de la loi n°94-126 Madelin pour les professions indépendantes etc. [13]
Historique
Moyen-âge, ancien-régime et XIXe siècle
La vie des anciens a longtemps reposé sur la solidarité inter-générationnelle et de menus travaux artisanaux. De nombreuses formes d'entraide volontaires existaient dès le Moyen-Age : corporations, sociétés de secours mutuels.
Sous l'Ancien Régime, 60 000 pensionnaires recevaient une rente de la part du roi. Ce dernier prélevait sur son trésor royal pour distribuer des pensions de cour, des pensions de charité, de mérite et de conversion, les pensions de retraite ne concernant quant à elles que 0, 1% de la population[14]. La première profession à obtenir une compensation en période d'inactivité est celle des marins sous Louis XIV, puis ce fut les militaires gradés, l'administration royale, le personnel des Maisons royales, le clergé et la Ferme générale, qui crée la première caisse de retraite française en 1768, alimentée par des retenues de 1, 25% à 2, 5% sur les salaires. A la Restauration, les rentes royales sont à nouveau payées, sur la liste civile.
Après la révolution de 1848, la totalité des fonctionnaires bénéficie d'une retraite, à partir de 1853. Pour le secteur privé, les sociétés de secours mutuels ont permis un palliatif, mais leur développement était entravé par la réglementation, les pouvoirs publics craignant une agitation ouvrière. La pression populaire augmentait par conséquent, comme en témoigne la légalisation du syndicalisme.
Avant 1910, les mineurs et les cheminots
Certaines professions finirent par obtenir des droits à la retraite : en 1850, les premières compagnies privées de chemins de fer créèrent des caisses de retraite pour certains de leurs employés (création des régimes spéciaux) et en 1894 les mineurs obtinrent, dans un cadre obligatoire, l'assurance maladie et un régime de retraite, suivis, en 1897, par les travailleurs des arsenaux et de l'armement[15].
La question sociale rendait plus urgente une solution globale ; certains préconisèrent d'imiter le modèle des assurances sociales allemandes instaurées sous Bismarck par trois lois votées en 1883, 1884 et 1889. Cependant, ce projet réformiste était alors vu d'un bord comme un grand pas révolutionnaire vers le socialisme et une création de charges intolérables pour les entreprises, de l'autre bord au contraire comme un obstacle à la Révolution. Du projet défendu par Martin Nadaud en 1879-1880 aux réalisations concrètes, il faudra attendre 30 ans.
La loi sur les "retraites ouvrières et paysannes" de 1910
La loi sur les «Retraites ouvrières et paysannes» (ROP) créé des dispositifs de retraite par capitalisation à adhésion obligatoire, défendus par des membres du Parti Radical comme Léon Bourgeois et Paul Guieysse, qui bénéficient à 3 millions de salariés sur 8 millions, et 40 millions de français. Le projet est vivement combattu par le patronat, qui dénonce des charges intolérables et l'encouragement à la paresse.
La première Guerre mondiale provoque l'afflux d'anciens combattants. Les responsabilités de l'État sont plus couramment acceptée par une large frange de la population. Le retour des trois départements d'Alsace-Moselle, pose la question de supprimer le modèle bismarckien qui s'y applique, ou de l'étendre au reste du pays. La seconde solution est retenue, la France étant alors le dernier pays européen sans assurance sociale générale.
Les querelles se poursuivront jusqu'en 1930, pour savoir qui de l'État, des syndicats, du patronat ou de la mutualité doit gérer ce dispositif. Un compromis est trouvé : protection maladie par répartition et capitalisation pour la retraite, tous deux obligatoires, couvrant théoriquement 10 millions de personnes en 1930 et 15 en 1941.
Le dispositif de retraite par capitalisation est cependant pénalisé par les dépréciations monétaires de 1910 et 1918, dues à la politique inflationniste du gouvernement, visant à calmer l'agitation sociale.
Confiscation des sommes capitalisées en 1941
Selon l'économiste Jean-Marie Harribey (université de Bordeaux), en 1941, "le régime de Vichy transforme ce dispositif qui fonctionne par capitalisation, ruiné suite à la crise, en dispositif par répartition"[16].
Selon l'économiste Philippe Simonnot (université de Paris X et Versailles), "la «loi de répartition» de mars 1941, comme elle se nomme et qui mérite bien son nom, permit d'affecter au paiement de l'Allocation aux Vieux Travailleurs Salariés les cotisations recouvrées dans le cadre du précédent régime par capitalisation"[17] Le dispositif précédant n'était par conséquent pas ruiné.
Maintien du dispositif par répartition en 1945
Création de la sécurité sociale
La Sécurité sociale est l'une des réalisations majeures du programme du Conseil national de la Résistance. En matière de retraite, l'œuvre de Pétain (la répartition) est conservée, mais les dispositifs professionnels reprennent leur autonomie.
Il en résulte le développement de quantités de régimes différents ; les plus riches (notaires par exemple) auront les moyens de prélever des cotisations élevées, servant à verser assez tôt (à 60 ou alors 55 ans) des pensions assez élevées ; d'autres (industries sous monopole d'état surtout : SNCF, EDF, mines, ... ) obtiendront le même résultat par une participation massive de leur employeur ; d'autres enfin, par choix ou manque de moyens, ne mettront en place que des cotisations faibles ne servant à financer que des pensions tardives et faibles, ou alors misérables (commerçants, agriculteurs).
Il apparait que les évolutions démographiques professionnelles sont à prendre en compte, et que la justice sociale nécessite des transferts entre caisses. L'exemple du régime des agriculteurs est spécifiquement illustratif : tandis que le nombre de pensionnés augmente sans cesse, le nombre de cotisants y chute sous l'effet du progrès technique et de l'exode rural, qui conduit les jeunes à adopter d'autres métiers, et par conséquent grossir le nombre de cotisants aux caisses des métiers en expansion. Il est évident que ces caisses doivent verser à la caisse agricole (et aux autres qui subissent le même phénomène, quoiqu'avec une ampleur bien moindre) une compensation. Des dispositifs complexes de calcul des sommes concernées (entrantes ou sortantes selon que la caisse perd des cotisants ou en gagne) sont mis en place, et pour solder les désaccords, plutôt que de trancher l'état verse une obole (le Budget Annexe des Prestations Sociales Agricole, devenu Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles en 2005).
A ce dispositif "bismarckien", la France ajoute une composante "beveridgienne", sous forme d'un minimum vieillesse et de droits à retraite spécifiques pour les mères de familles par exemple.
Premières évolutions
En 1953, une première tentative de regrouper dans le régime général les régimes spéciaux (mineurs... ), fortement contesté, avorte. La Sécurité sociale est réorganisée en quatre branches vers 1966 : création de la CNAM, de la CNAV, de la CNAF et de la branche AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles), qui doit atténuer les risques liés au travail.
La démographie impose dès les années 1960 de réévaluer les cotisations. Des professions qui avaient choisi de garder des régimes spécifiques rejoignent le régime général.
En 1981, François Mitterrand accorde la retraite à partir de 60 ans, pour 37, 5 années de cotisation. La hausse du chômage depuis 1973 et qui s'aggrave toujours commence à peser sérieusement sur les cotisations, tout en mettant les chômeurs âgés en difficulté.
Le principe de partage du travail, la volonté de lutter particulièrement contre le chômage des jeunes, et l'intérêt des entreprises qui souhaitent licencier mais ne peuvent le faire pour des raisons légales amènent à inventer la pré-retraite.
Réformes des retraites après 1990
1993 : La réforme Balladur
Quand il arrive à Matignon en 1993, le nouveau Premier ministre constate un déficit sans précédent : 40 milliards de francs. La récession causée par la crise monétaire consécutive à la réunification allemande frappe de plein fouet les recettes, observe le quotidien Les Échos.
Devant cette situation, le gouvernement Édouard Balladur, dans lequel Nicolas Sarkozy est ministre du Budget, lance une réforme des retraites au pas de charge. Une loi d'habilitation à légiférer par ordonnance est rapidement votée, ainsi qu'à l'été 1993 la réforme est terminée. La totalité n'aura pris que quelques semaines[18], [19].
Cette réforme, qui ne concerne que le secteur privé, tient en cinq principales mesures :
- la durée de cotisation indispensable pour avoir droit à une pension à taux plein passe progressivement de 150 trimestres (37 ans et demi) à 160 trimestres (40 ans) [20], à raison d'un trimestre de plus par an du 1er janvier 1994 à 1er janvier 2004 ;
- création d'une décote pour chaque trimestre de cotisation manquant (2, 5% par trimestre, soit 10% par an). En pratique, la majorité des gens remplissent la condition de cotisation à 60 ans ou même avant, ce qui limite la portée de cette disposition[21]
- augmentation de la durée de carrière de référence : la pension était auparavant calculée sur les 10 meilleures années, durée qui sera progressivement portée à 25 années (atteint en 2010, à raison d'une année de plus par an) [20].
- changement du mode d'indexation des pensions de retraites. Elles seront désormais alignées sur l'inflation (mesurée par l'indice des prix à la consommation), tandis qu'elles étaient auparavant indexées sur l'évolution des salaires.
- création d'un fonds de solidarité vieillesse (FSV) chargé de financer quelques systèmes (minimum vieillesse, avantages familiaux…) [22]
Cette réforme atteint partiellement ses buts.
En matière de réduction des pensions comparé à la situation antérieure, selon une étude de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés publiée en 2008, pour six retraités sur dix, la réforme Balladur des retraites de 1993 a «conduit au versement d'une pension moindre que celle à laquelle ils auraient pu prétendre sans réforme». La différence moyenne est de 6 % pour la totalité de la population. Les hommes nés en 1938, par exemple, reçoivent une pension moyenne annuelle de 7.110 euros par an (hors retraites complémentaires), 660 euros de moins que si la réforme n'avait pas eu lieu[18], [19].
En matière de durée d'activité, une autre étude, du ministère du Travail, réalisée en 2009 a estimé que depuis cette réforme, les hommes ont en moyenne repoussé leur cessation d'activité de 9 mois et demi[23] et les femmes de 5 mois. En 17 ans, la durée de cotisation moyenne n'aurait par conséquent augmentée que de 8 mois ou moins, compte tenu d'une arrivée plus tard sur le marché du travail. La réforme de 1993, qui augmentait de 30 mois la durée de cotisation indispensable pour avoir une retraite complète, aurait par conséquent raté à 70 % son premier objectif : avoir plus de cotisations.
Ceci explique en partie que l'objectif principal, rétablir l'équilibre financier du dispositif, a échoué. Le volume de cotisations n'a pas augmenté tout autant qu'escompté.
1995 : l'échec du plan Juppé
Confronté au même genre de difficulté budgétaire, Alain Juppé s'attaque au problème des régimes spéciaux de retraite et au rapprochement du régime de la fonction publique au régime général. Voté triomphalement au parlement, avec la bienveillance de l'opposition, son plan se fracasse sur les grèves de 1995 et son gouvernement fait machine arrière.
Après cet échec, le gouvernement fait voter alors la mise en place de fonds de pension, dans le cadre de la "loi Thomas".
1999 : création du Fonds de réserve pour les retraites
La gauche, au pouvoir à partir de 1997, ne lance pas de nouvelle réforme mais, dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale de 1999, elle crée le Fonds de réserve pour les retraites (FRR). Cet instrument, conçu comme temporaire, était conçu pour couvrir la pointe de besoin de financement du régime général à partir 2020, anticipée pour des raisons démographiques[24].
Ce fonds ne recevra jamais les sommes à hauteur du besoin, estimé à 150 milliards d'euros[réf. nécessaire], même pendant les périodes de bonne croissance économique des années 1999, 2000 et 2001, puis ne touchera plus grand chose à partir de 2002. Ayant été pourvu au total de 29 milliards d'euros de 1999 à fin 2009, il ne représentait à cette date une réserve que de 33 milliards d'euros[25]
Les sommes en jeu, quoiqu'inférieures aux besoins selon la finalité d'origine, restent néanmoins importantes, et tentantes pour un gouvernement dont le budget est déficitaire. Les syndicats CFDT, CGC, CGT, FO, et CFTC ont ainsi manifesté leur inquiétude par écrit au président de la République le 7 janvier 2008, à propos de rumeurs d'utilisation prématurée du fond. Dans le cadre de la réforme de 2010, le FFR serait effectivement mis à contribution dès 2011.
2003 : réforme Fillon
La majorité de droite élue en 2002 entreprend une réforme des retraites sous l'égide du ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, François Fillon.
Elle généralise aux fonctionnaires la décote pour années manquante. La «réforme Fillon» (ou «loi Fillon») instaure une transition progressive de la durée de cotisation de l'ensemble des régimes, sauf les régimes spéciaux, vers 42 ans. Est ainsi décidée tout d'abord d'aligner la durée de cotisation des fonctionnaires : elle est ainsi allongée de 37 ans et 1/2 à 40 ans à l'horizon 2008, à raison d'un semestre par an.
Par contre, cette réforme diminué la durée de cotisation des personnes qui ont commencé à travailler particulièrement jeunes : ils peuvent partir en retraite anticipée avec 42 ans de cotisations. Les plus de 17 ans sont cependant exclus du système et doivent par conséquent continuer à partir à 60 ans. La décote pour années manquantes doit tendre pour l'ensemble des salariés à 5 % par année manquante à l'horizon 2015 dans la limite de cinq années (soit 25 % de décote maximale). Une * Surcote pour années supplémentaires est instaurée (de 3 %) par année supplémentaire au delà de la durée de cotisation indispensable pour obtenir une retraite à taux plein. Le cumul emploi–retraite est rendu plus flexible.
Le mode d'indexation choisi reste l'indexation sur les prix ; le pouvoir d'achat des retraités est par conséquent préservé constant tout au long de leur retraite.
Les salariés peuvent racheter des trimestres au titre des études, dans la limite de 3 ans (avec un coût assez important : la DRESS évalue le montant moyen des rachats à 22 000 €) .
De nouveaux produits d'épargne individuels (le PERP) et collectif (le PERCO) sont créés (système de capitalisation).

Selon la loi Fillon de 2003, la durée de cotisation doit être augmentée d'un an, à raison d'un trimestre par année, à partir de 2009. Cependant la loi Fillon précise que cette augmentation peut être ajournée si le contexte est modifié, «au regard des évolutions» du taux d'activité des personnes de plus de 50 ans, de «la situation financière des régimes de retraite, de la situation de l'emploi» et de «l'examen des paramètres de financement des régimes de retraite»[26].
2007 : réforme des régimes spéciaux
La réforme des régimes spéciaux[27], qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2008, avait pour objectif d'aligner la durée de cotisation des agents de la SNCF, de la RATP et des IEG (Industries électriques et gazières) sur celle du privé et de la fonction publique, comme l'avait promis à plusieurs reprises Nicolas Sarkozy lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2007 en France.
La réforme prévoit l'augmentation progressive de la durée de cotisation, de 37, 5 ans en 2007 à 40 ans en 2012, pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Depuis le 1er juillet 2009, les pensions sont indexées sur l'inflation. Enfin, à compter du 1er juillet 2010 sera introduit une décote réduisant la retraite en cas de trimestre manquant. Cette réforme revient à étendre à un demi-million de salariés qui y échappaient toujours la Réforme Balladur des retraites de 1993, comme la Loi Fillon (retraites) l'avait étendue en 2003 aux 5 millions de fonctionnaires.
Après la réforme des régimes de retraites spéciaux de fin 2007, le rendez-vous de 2008[28] faisait partie du calendrier décidé lors de la réforme de 2003, avec pour thème, essentiellement dans le secteur privé :
- Définir le niveau minimal d'une retraite pour un salarié qui a effectué une carrière complète ;
- Réexaminer le système de départ anticipé pour carrières longues ;
- Déterminer les moyens d'équilibrer les régimes de retraite.
Les propositions des syndicats n'ont pas été retenues, ce qui les a amené à organiser une journée de manifestation pour protester, en mai 2008. Les principales décisions prises par le gouvernement dans le cadre de ce rendez-vous furent :
- L'allongement de la durée de cotisation à 41 ans pour l'année 2012? à raison d'un trimestre par an.
- La revalorisation de 25% du minimum vieillesse, entre 2007 et 2012;
- Le rétablissement par la loi d'un minimum de 55 ans au moins pour obtenir la pension de réversion ;
2010 : Une nouvelle réforme
Lors de la campagne présidentielle de 2007, le candidat qui sera élu, Nicolas Sarkozy, avait parlé principalement de la réforme des régimes spéciaux de retraite (cheminots, électriciens). Les prévisions de déficit ayant été revues en forte hausse à cause de la crise bancaire, le gouvernement a décidé une réforme plus large en 2010.
Un problème de financement aggravé par la crise
Selon des projections du COR[29], contestées[30] par les syndicats[31], en 2010 le total du déficit des régimes de retraite s'élèverait à 32 milliards d'euros en raison du pic de départ à la retraite des générations du baby-boom nées entre 1945 et 1950 (âgées de 60 à 65 ans en 2010). Pour 2020, il estime que le déséquilibre serait fortement croissant : 182 cotisants pour 100 retraités en 2006, 170 pour 100 en 2010, 150 pour 100 en 2030 et 121 pour 100 en 2050.
Tandis qu'en 2007, avant la Crise économique de 2008-2010, le COR estimait le besoin de financement des retraites à à peu près 25 milliards d'euros en 2020 (soit 1 point de PIB) [26], dans son document de 2010 il estime ce même besoin à 45 milliards d'euros (soit 1, 86 point de PIB), chiffre qui monterait à 70 milliards € en 2030 et 100 milliards € en 2050.
Calendrier des annonces
- Le 14 avril 2010, le Conseil d'orientation des retraites (COR) a rendu un rapport soulignant l'impact de la crise financière de 2008 sur le financement du dispositif de retraite, l'augmentation rapide du chômage diminuant les cotisations. Éric Wœrth, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique, a ensuite indiqué le 24 avril 2010 qu'il souhaitait reporter l'âge légal de départ à la retraite.
- Le 16 mai 2010, Éric Wœrth a transmis aux partenaires sociaux un "document d'orientation" du gouvernement sur la réforme des retraites, qui[32] déclare que seule l'augmentation progressive de la durée d'activité peut répondre au "choc démographique".
- Le 16 juin, Éric Wœrth a annoncé le passage de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans contre 60 ans plus tôt, ce qui a accentué les Grèves contre la réforme française des retraites de 2010, des grèves et manifestations organisées par les huit principaux syndicats.
Parallèlement, d'autres partis politiques ont préparé leur projet de réforme. Alors que l'UMP[33] se prononce pour une augmentation du temps de travail, au moyen d'un report de l'âge légal de départ à la retraite, l'opposition (Parti Socialiste, Europe Écologie et Parti Communiste surtout) propose d'élargir l'assiette de cotisation, afin d'augmenter les recettes, et de taxer les revenus du capital.
Contenu de la réforme
L'avant-projet de loi sur les retraites présenté le 16 juin repose sur deux principales mesures :
- le relèvement progressif en 6 ans (à raison de 4 mois par an) de l'âge légal de départ à la retraite, de 60 à 62 ans
- le relèvement de l'âge de départ à taux plein (sans subir de décote pour années manquantes) de 65 à 67 ans.
À ces deux mesures principales s'ajoutent une série d'autres points :
- le maintien du Dispositif pour carrière longue avec cependant un durcissement des conditions d'accès à ce système dans la mesure où il faudra avoir cotisé 43 ans et 1/2 (contre 42 ans lors de l'instauration de ce système). Les personnes ayant commencé à 14 ans devraient aller jusqu'à 58 ans (contre 56 jusque là).
- la mesure de l'invalidité : un certificat de la médecine du travail prouvant une invalidité de 20% permettra de partir à 60 ans.
- le passage (étalé sur 10 ans) de 7, 85 % à 10, 55 % du taux de cotisation retraite dans la fonction publique
- le relèvement de 2 ans de l'âge de départ à la retraite de certaines catégories de fonctionnaires dites "d'active"
- l'utilisation anticipée du Fonds de réserve pour les retraites, censé n'être utilisé qu'à partir de 2020 [34], [35] ;
- le gel de l'effort financier de l'État pour le financement du régime de retraite des fonctionnaires [35] ;
- l'allongement de la durée de cotisation de 41 ans à 41 ans et 1/2 à l'horizon 2020
- la mise à contribution de certains revenus (prélèvement additionnel de 1 % sur la dernière tranche d'impôt sur le revenu ;
- l'augmentation d'un point des prélèvements sur plus-values de cessions mobilières et immobilières et du prélèvement forfaitaire sur dividendes et intérêts
- l'augmentation des prélèvements sur les stock-options et sur les retraites-chapeaux
- à partir de 2015, en cas de baisse significative du chômage, un basculement d'une partie des cotisations chômage sur les cotisations retraite[36] et son financement sur le dossier de presse[35].
Le projet de loi portant la réforme des retraites est présenté le 7 septembre 2010 à l'Assemblée nationale, jour où s'accentue les Grèves contre la réforme française des retraites de 2010. Le syndicats estiment qu'un ouvrier devra en moyenne cotiser 3, 14 années pour une année de retraite contre 2, 64 années avant la réforme[37].
retraites complémentaires et retraite des parlementaires
- Au régime de base s'ajoute le régime de retraite complémentaire des salariés, calculé en points. Ce régime a été rendu obligatoire par la loi du 29 décembre 1972, pour les salariés relevant du régime général et du régime des salariés agricoles, mais pas pour les fonctionnaires. Il est financé par des cotisations sociales, patronales (60 %) et salariales (40 %), qui permettent d'obtenir des points, dont la valeur est régulièrement revalorisée. Les points accumulés s'ajouteront à la pension du régime de base[38].
- Le régime de retraite spécial des parlementaires est régulièrement critiqué comme trop généreux. En 2010, un ex-député touche en moyenne une pension 2 700 euros net par mois et un ex-sénateur 4 442 euros, pension calculée au prorata des annuités acquises. Les parlementaires ont le droit de cotiser double les quinze premières années, puis 1, 5 fois les cinq années suivantes. Il est par conséquent envisageable de toucher une retraite pleine en ayant cotisé 25 années. L'indemnité perçue par les anciens présidents de la République au titre de la retraite, elle , ne dépend pas du temps de cotisation : 63.000 euros bruts par an, soit 5.250 euros par mois, quel que soit le nombre de mandats[39].
Cette critique est ressortie sur fond de manifestations de rues et de Grèves contre la réforme française des retraites de 2010[40], particulièrement quand l'amendement N°249 tendant à aligner ce régime spécial sur le régime général a été rejeté à l'unanimité[41].
Pénibilité et invalidité
Dans le cadre de la réforme de 2010, un des thèmes qui occupe la scène est celui de la pénibilité. Si l'idée de tenir compte de cette notion pour moduler les conditions d'accès à la retraite ne pose pas de problème de principe (pour certaines professions exposant à des contraintes spécifiques, il est déjà envisageable de prendre sa retraite plus tôt que dans le régime de droit commun), sa concrétisation est plus délicate.
Les expositions aux contraintes physiques : port de charges lourdes, mauvaises postures, horaires variables, travail de nuit usent prématurément. Les statistiques indiquent que ce sont ces mêmes séniors, usés par le travail, qui se retrouvent dans la précarité. Trop jeunes pour partir avec une retraite à taux plein et trop vieux pour continuer de travailler, ils risquent d'être en longue maladie ou licenciés, situation pénible, physiquement et moralement dans les deux cas[réf. nécessaire].
Des négociations entre les partenaires sociaux pour définir exactement les critères de pénibilité (et les compensations à prévoir) ont été engagés depuis 2005 mais n'avancent plus.
Le gouvernement a proposé d'utiliser la notion plus classique et mieux définie d'invalidité. Dans l'avant-projet de la réforme 2010 des retraites, seules les personnes ayant un taux d'incapacité égal à 20% pouvaient prendre leur retraite à 60 ans. 30.000 personnes soit 4% à 5% de celles partant à la retraite auraient été concernées[réf. nécessaire]. En l'état actuel du processus d'adoption, le taux d'incapacité requis serait de 10% sous condition qu'une commission pluridisciplinaire valide cette incapacité. Les syndicats ne se satisfont pas de cette disposition : ils estiment que la pénibilité ne peut se diminuer à l'invalidité, et que par conséquent la question de la pénibilité doit être traitée en soi.
Situation fin 2010
| Droit du travail en France |
| Sources du droit du travail |
| Relations individuelles |
| Rupture du contrat de travail |
| Relations collectives |
|
| Justice du travail |
| Voir aussi |
|
Quelques chiffres
Le nombre de retraités ayant-droit (percevant une pension) passe de 13, 6 millions en 2005 à 14, 5 millions en 2007[42]. En 2007, la pension moyenne (base plus complémentaire obligatoire) s'élève à 1095 Euros et 600 000 personnes bénéficient du minimum vieillesse dont le montant est alors de 628 euros par mois. Le taux de remplacement du salaire individuel moyen est en France de 54%, un peu inférieur à la moyenne OCDE (un peu moins de 60%) [43].
Au 1er juillet 2007, 21 906 578 pensions étaient servies dans la totalité des régimes de sécurité sociale[44]. La répartition entre régimes s'établit comme suit :
- Les régimes des salariés représentaient 82, 03% du total, parmi lesquels
- Régime général : 55, 49% du total
- Régime des salariés agricoles : 11, 11 % du total
- Fonctionnaires civils et militaires : 9, 27%
- Collectivités locales : 3, 83%
- Divers régimes spéciaux (mines, SNCF, ouvriers de l'Etat etc. ) : 5, 33%
- Les régimes de non salariés : 17, 97%
En 2007 les pensions représentaient 13, 3 % du PIB français selon l'Insee[45], 13 % selon l'OCDE[43]. Cet indicateur, qui inclue des retraites complémentaires accessibles uniquement aux cadres, ne permet pas réellement des comparaisons internationales du fait de la part particulièrement variable selon les pays des retraites publiques obligatoires, quelquefois fortement complétée par des retraites facultatives privés non prises en compte dans le calcul (cas du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Espagne par exemple).
Les 261 G€ versés comme pensions en 2008[46] se décomposaient en
- régime général : 88, 5 G€
- autres régimes : 154, 5 G€ dont[47]
- interventions sociales des pouvoirs publics : 12 G€
- divers autres régimes (mutualité, supplémentaires... ) : 6, 0 G€
En général, les dépenses de retraite croissent significativement plus vite que l'économie française, jamais moins de 4, 2% depuis 2001[46].
En 2007, le régime général de retraite présente un solde négatif de 5, 6 milliards d'euros[51].
Concernant les systèmes d'épargne-retraite, selon l'Insee, «En 2007, 10, 8 milliards d'euros de cotisations ont été collectés [... ], alors que 3, 9 milliards d'euros ont été versés aux bénéficiaires.»[52]
éléments sociologiques
pension moyenne... (par sexe / age)
minimum vieillesse (niveau, nombre... )...
patrimoine moyen des retraités
...
Âge de départ : le tableau des trimestres requis selon l'année de naissance
En 2009[53], la moyenne de départ à la retraite est de 61, 36 ans pour les hommes et 61, 68 ans pour les femmes, soit 61, 52 ans pour tous. Ce chiffre est différent de l'âge de cessation d'activité, où la personne peut se retrouver au chômage, en préretraite ou en dispense de recherche d'emploi, avec de simples indemnités de chômage. La France était en 2005 le pays où on cesse de travailler le plus tôt en moyenne : 58, 5 ans pour les hommes, 59, 2 ans pour les femmes[54], mais sans pour tout autant partir à la retraite.
Entre 60 et 65 ans, le salarié subit une décote pour années manquantes de cotisation, de 5 % (assuré né à partir de 1953) à 10 % (assuré né à avant 1944) par année[55]. Le maximum est plafonné à 25% de sa retraite. La retraite du régime de base étant égale à 50 % du salaire (de base référence SS) des 25 meilleures années, le salarié ne touchera tandis que 40% du dernier salaire.
Le salarié au chômage qui n'a pas le nombre de trimestres nécessaires à une retraite à taux plein[10], sans décote pour années manquantes dépend jusqu'à son 65e anniversaire des Assedic, échéance reportée à 67 ans par la réforme 2010 des retraites. Il a droit au minimum vieillesse, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Au 1er avril 2010, son montant maximum est de 708, 95 € par mois pour une personne et de 1157, 46 € par mois, si elle fait vivre deux conjoints, concubins ou pacsés.
Le nombre de trimestres requis pour obtenir une retraite à taux plein, sans décote pour années manquantes, dépend de l'année de naissance du salarié[56] :
| Année de naissance | Nombre de trimestres requis |
|---|---|
| Avant 1934 | 150 trimestres |
| 1934 | 151 trimestres |
| 1935 | 152 trimestres |
| 1936 | 153 trimestres |
| 1937 | 154 trimestres |
| 1938 | 155 trimestres |
| 1939 | 156 trimestres |
| 1940 | 157 trimestres |
| 1941 | 158 trimestres |
| 1942 | 159 trimestres |
| à partir de 1943 | 160 trimestres |
La réforme Fillon de 2003 a rallongé jusqu'à 164 trimestres la durée de cotisations[10] :
| Année de naissance | Nombre de trimestres requis |
|---|---|
| 1949 | 161 trimestres |
| 1950 | 162 trimestres |
| 1951 | 163 trimestres |
| 1952 | 164 trimestres |
Dans le cas où le salarié souhaite partir avant d'avoir cotisé ce nombre de trimestres, sa pension de retraite sera minorée de 1, 25 % à 2, 5 % par trimestre manquant selon l'année de naissance[55].
Notes et références
- Ce semble être le cas du second rapport de la Libération sur la croissance dirigé par Jacques Attali Voir Le Canard enchaîné du 20 octobre 2010 qui dans son article «Un rapport douloureux pour le Président» écrit que le rapport «reproche, entre les lignes, au gouvernement de n'avoir pas mis sur pied un dispositif par points»
- Entretien avec Thomas Piketty pour La vie des idées
- Bruno Palier, Cahiers français 2010 p. 16
- Article 39 du code général des impôts
- Article 82 du code général des impôts
- Article 83 du code général des impôts
- Voir [1]
- Site de l'ERAFP - Qu'est-ce que la retraite additionnelle ?
- La Croix, "Tout savoir sur les régimes spéciaux", Jeudi 18 octobre 2008
- Nombre de trimestres nécessaires à l'obtention du taux plein sur le site de la CNAV
- Projet de loi portant réforme des retraites : Rapport, Article 4 sur le site du Sénat français
- Présentation de la réforme des retraites, par Éric Wœrth le 16 juin 2010 sur le site du Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique
- Pour plus de détail, voir TEF (Tableaux de l'économe française), 2010, p. 69
- Laurence Lautrette, Le droit de la retraite en France, Ed. PUF Que Sais-Je, 1999
- Michel Pigenet, Retraites : une histoire des régimes spéciaux, ESF éditeur, 2008
- [pdf]Jean-Marie Harribey (université de Bordeaux), notes de cours, consultées octobre 2009
- Crise des retraites : le cadavre de Pétain bouge toujours ! sur www. claudereichman. com
- Retraite : les trois réformes qui ont changé nos vies, par Vincent Collen, dans Les Échos, le 16 février 2010
- Retraite : les trois réformes qui ont changé nos vies sur www. lesechos. fr
- Projet de loi portant réforme des retraites : réforme des retraites, rapport sur www. senat. fr
- «Il n'y a pas eu de réaction massive des salariés parce que les gens qui devaient partir en retraite entre 1995 et 2000 avaient commencé à travailler tôt, vers 16-17 ans, quelquefois avant, fréquemment sans interruption due au chômage, et savaient qu'ils pourraient compter sur 38 ou 39 ans de cotisation au moment d'arriver à 60 ans, selon Vlady Ferrier, représentant CGT au Conseil d'orientation des retraites» La réforme Balladur, bombe à retardement, par Murielle Grémillet, Libération du 21 décembre 2000 La réforme Balladur, bombe à retardement - Conséquence du calcul sur les vingt-cinq meilleures années : des pensions amputées. sur www. liberation. fr
- Les réformes des retraites de 1993 à 2008 sur www. vie-publique. fr, 23.06.2010. Consulté le 20 octobre 2010.
- Dossiers d'actualité : les réformes des retraites de 1993 à 2008, sur Viepublique. fr (site appartenant au gouvernement)
- [2]
- [pdf] (page5) fonds de réserve sur www. fondsdereserve. fr. Consulté le 20 octobre 2010.
- Une nouvelle réforme des retraites en discussion au ministère du travail, Le Monde, 27 mars 2003
- La réforme des régimes spéciaux
- La réforme des retraites 2008, sur le site de la CFDT
- Rapport du 14 avril 2010, Conseil d'orientation des retraites
- "Retraites : des projections alarmantes, qui ne mettent personne d'accord", par AFP, sur le site de l'Express, le 14/04/2010
- http ://www. lexpress. fr/actualites/1/retraites-des-projections-alarmantes-qui-ne-mettent-personne-d-accord_884600. html
- Document d'orientation du Gouvernement sur la réforme des retraites, 2010
- Réforme des retraites : une impérieuse obligation, sur le site de l'UMP
- La totalité des mesures d'augmentation de la durée d'activité et des recettes permettront de remettre les régimes de retraite à l'équilibre en 2018. Les déficits accumulés durant cette période seront totalement transférés à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), qui aura la propriété des actifs et des ressources du Fonds de réserve des retraites. Le FRR restera le gestionnaire de ces actifs et de ces ressources, pour le compte de la CADES
- Dossier de presse : présentation réforme des retraites
- Avant-projet de réforme des retraites
- http ://eco. rue89. com/2010/10/21/pourquoi-la-reconstitue-des-retraites-est-injuste-demonstration-en-chiffres-172486?page=0#comment-1864873
- Le régime de retraite complémentaire
- La retraite du Président de la République
- Retraites : la réforme suspendue (pour les parlementaires)
- AMENDEMENT N° 249
- TEF (Tableaux de l'économe française), 2010, p. 69
- Les retraites en France ainsi qu'à l'étranger, 7 indicateurs clés, OCDE
- Statistiques de la branche retraite - Les retraites servies dans la totalité des régimes de sécurité sociale, caisse nationale de l'assurance vieillesse
- Part des dépenses de pensions dans l'Union européenne
- [pdf]Les comptes de la protection sociale en 2008, études de la DREES n°733, juillet 2010
- attention, les chiffres qui suivent n'étant pas issu de la même source ni produit à la même date, des incohérences sont susceptibles d'exister.
- http ://www. performance-publique. gouv. fr/farandole/2008/rap/pdf/DRGNORMALMSNYD. pdf pensions 2008
- [pdf]agirc-arrco chiffres clés 2008
- http ://www. agirc-arrco. fr/qui-sommes-nous/chiffres-cles/#c575
- Statistiques de la branche retraite, caisse nationale de l'assurance vieillesse
- Dispositifs d'épargne retraite au 31 décembre, commentaires
- Le régime général de retraite, CNAV
- page 44, L'Europe dans la mondialisation, Colloque du Centre d'analyse stratégique, nov. 2007
- Article R351-27 du code la Sécurité Sociale
- Article R351-45 du code la Sécurité Sociale
Voir aussi
Rapports gouvernementaux et textes juridiques de référence
En 1991, Michel Rocard publie un livre blanc sur les retraites, qui ne donne lieu à aucune réforme. C'est le premier d'une longue liste de rapports :
- 1991 : livre blanc de Michel Rocard, discret sur la question de la décote pour années manquante
- 1995 : rapport Briet, qui entérine la décote pour années manquante
- 1995 : rapport de Foucauld
- 1996 : contributivité
- 1998 : retraites et épargne (Les Rapports du Conseil d'analyse économique, n° 7)
- 1998 : rapport Malinvaud - Les cotisations sociales à la charge des employeurs : analyse économique
- 1999 : rapport Vasselle
- 1999 : rapport Plancade
- 1999 : rapport Charpin
- 2000 : rapport Teulade
- 2000 : rapport Tadei
- 2001 : 1er rapport du COR - Retraites : renouveler le contrat social entre les générations, orientations et débats
- 2001 : rapport sur la Suède et l'Italie
- 2002 : démographie et économie
- 2004 : 2ème rapport du COR - Retraites : les réformes en France ainsi qu'à l'étranger ; le droit à l'information
- 2006 : 3ème rapport du COR - Retraites : perspectives 2020 et 2050
- 2007 : 4ème rapport du COR - Retraites : questions et orientations pour 2008
- 2007 : 5ème rapport du COR - Retraites : 20 fiches d'actualisation pour le rendez-vous de 2008
- 2008 : 6ème rapport du COR - Retraites : droits familiaux et conjugaux
- 2010 : 7ème rapport du COR - Retraites : annuités, points ou comptes notionnels ? Options et modalités techniques
- 2010 : 8ème rapport du COR - Retraites : Perspectives actualisées à moyen et long terme en vue du rendez-vous de 2010
Les Textes juridiques de référence sont en cours d'actualisation.
Bibliographie
-
- Insee, 2010, Tableaux de l'économie francaises Lire en ligne
- Bruno Palier, " Les caractéristiques de l'État-providence en France en France : son organisation, ses évolutions au gré des réformes", Cahiers français, n°358, Septembre-octobre 2010
- Bruno Palier, La réforme des retraites, PUF, collection "Que sais-je ?", Paris, 2010.
- Bernard Friot, L'enjeu des retraites, La Dispute, Paris, 2010.
- Antoine Rémond, Les retraites en question, La Documentation française, Paris, 2009.
- Antoine Bozio et Thomas Piketty, 2008, Pour un nouveau dispositif de retraite, édition rue d'Ulm
- Henri Sterdyniak, Gaël Dupont, Quel avenir pour nos retraites?, La Découverte, collection "Repères", Paris, 2000.
Liens et documents externes
- «Les engagements implicites des dispositifs de retraite», Insee, L'Économie française, 2006
- «Les dispositifs de retraite en Europe à l'épreuve des changements démographiques», Insee, Les dispositifs de retraite en Europe, 2004
- «Retraite par répartition ou par capitalisation : quelques enjeux économiques», Gabrielle Demange et Guy Laroque, Revue économique, 813-829, 2000
- «Retraites : supprimer les régimes spéciaux... ou changer de dispositif ?», Pascal Salin dans Les Échos, 12 octobre 2007
- Simulateur RETRAITES 2010 Calculez votre âge d'ouverture des droits à la retraite
- (fr) Projet de loi gouvernemental assorti de liens vers LégiFrance et commentable sur NosDéputés. fr
- Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse
- Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales
- Retraite sur le site du service public
- Site du Gouvernement sur la réforme des retraites
- Le GIP Info Retraite mis en place par la réforme Fillon
- Simulateur M@rel : Calcul des retraites (estimations)
- Conseil d'Orientation des Retraites
- Base nationale de législation sur la retraite (CNAV)
- Réformer les retraites : pourquoi et comment, Institut Montaigne, juin 2010
- Réforme des retraites : vers un big-bang ?, Institut Montaigne, mai 2009
- «Pourquoi votre retraite est menacée», L'Expansion, novembre 2006
- «Patrimoine : lorsque les ménages prennent de l'assurance», Insee première, mai 2005 Insee
- Dossier sur les retraites d'Attac France
- Informations sur le site du ministère du budget
- Site d'information sur l'actualité
- Site de décryptage de l'actualité politique en France
- Site d'information sur l'actualité
- Enquête sur la pénibilité des auxiliaires médicaux
- Site d'offre d'emploi/
- Marc Landré, Pénibilité au travail : l'éreintante négociation
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 04/11/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.


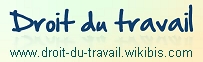
 Accueil
Accueil Recherche
Recherche Début page
Début page Contact
Contact Imprimer
Imprimer Accessibilité
Accessibilité